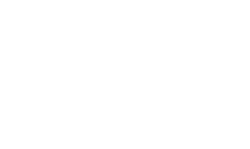Un peu d’histoire
Corse Indépendante
Au début du XVIIIe Siècle, de sérieuses révoltes ébranlent la République de Gênes. Elles sont dirigées par des nobles Corses et appuyées par l’Église.
L’expression de ces révoltes atteindra son paroxysme avec le retour en Corse en 1755 de Pasquale Paoli (né à Merusaglia, en Castagniccia, en 1725)
A cette date et pendant 11 ans, entre 1755 et 1769, la Corse va être indépendante.
Pasquale fait de Corti la capitale de l’île. Il y ouvre une université. Il bat monnaie et donne le droit de vote aux femmes. Pasquale Paoli contrôle presque toute la Corse. Dans le cap, il utilise les marines de Farinole et de Centuri. Les Génois ne contrôlent plus que les tours de Roglianu, Macinagghju et Brandu. Il envisage la création de marines à Chiapella et à Fornali en remplacement de celles de Macinaghju et San Fiurenzu, toujours en mains génoises.
En 1972, le Cap Corse changera de camp. C’est sous la pression des moines et du peuple que les notables Cap Corsins, réunis en Cunsulta (réunion politique décisionnelle) à Luri, se rallient à Paoli.
La Corse vendue à la France
En 1768, la République de Gênes ne contrôle plus que quelques citadelles. N’ayant plus d’espoir de reconquérir et de vaincre la nation Corse dirigée par Paoli, elle négocie avec la France. Le marché s’effectue en ses termes : Gênes cède la Corse et les Corses au royaume de France en échange de l’annulation de toutes les dettes génoises envers la France.
Le traité de Versailles est signé par Louis XV, qui entre en guerre contre Paoli. Les Français occupent tout le Cap Corse, la guerre commence.
Dans un premier temps, les troupes de Paoli sont victorieuses. Lors d’une bataille demeurée célèbre la France essuie une défaite à Borgu en 1768.
Louis XV prépare la revanche, et un an plus tard, en 1769, c’est à 10 contre 1 que les Français écraseront les troupes de Pasquale Paoli. La bataille aura lieu à Ponte Novu, le 9 mai.
Paoli doit alors s’exiler en Angleterre.
La Corse Française
1769 : La nation corse est vaincue… les ports et les principales agglomérations de l’île sont occupés par les Français.
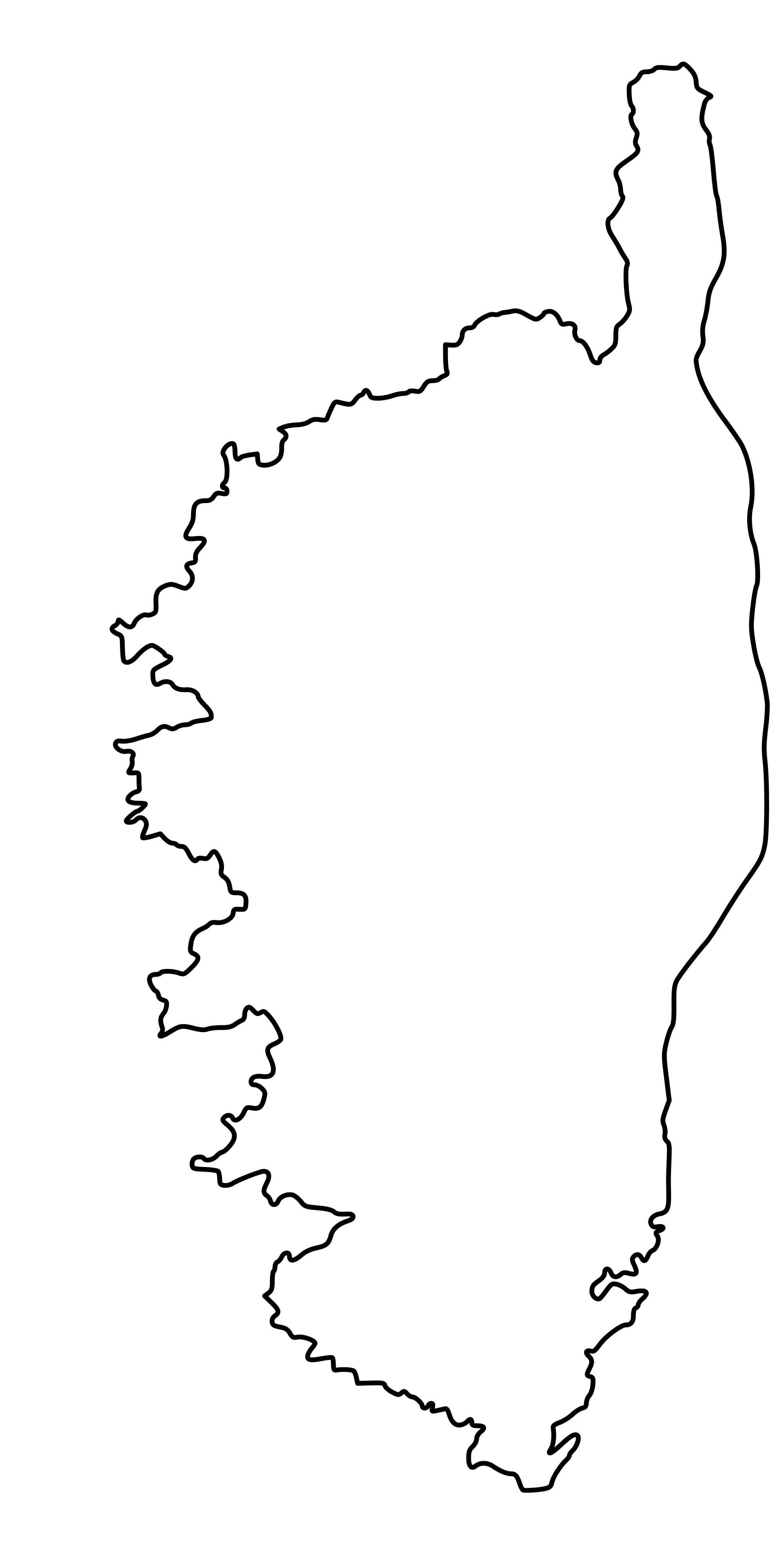
Ersa ( 7 hameaux ) en 1892
- Barcaghju 60 habitants 20 maisons
- Boticella 195 habitants 42 maisons
- Cucincu 185 habitants 44 maisons
- Granaghjulu 344 habitants 76 maisons
- Gualdu 25 habitants 11 maisons
- Piazza 40 habitants 3 maisons
- Poggiu (Poghju) 102 habitants 27 maisons
Agriculture, Viticulture, Population totale
- 951 habitants pour les 233 maisons
- 6 chevaux
- 71 mullets
- 7 voitures à 2 roues
- 28 bêtes à cornes
- 375 moutons
- 93 porcs
- 1 moulin
- 55 fours (2931kg)
- 6 puits
- 1 Ruisseau à sec en été
- 1 fontaine
Rapport confidentiel. “Descriptif et statistique sur le département de la Corse” – M DCCC XCII
Extraits du guide “Corse le Cap” avec l’aimable autorisation des éditions MédiaTerra.
Le rattachement de la Corse à la France
La révolution Française divise le Cap Corse en 4 cantons et supprime la province du Cap Corse : la nouvelle République abolit les droits féodaux.
Pendant la période 1800-1820, le Cap Corse possède une économie ouverte avec achats de bien de consommation hors du Cap, Corse, grâce à l’existence d’une marine cap corsine, qui compte plus de 200 voiliers (100 pour Macinaghju) et plus de 1000 mariniers.
Le commerce du Cap Corse continue d’être prospère jusqu’en 1830, date des premiers bateaux à vapeur : les marins cap corsins écoulent leur vin et se procurent ce que leur région ne produit pas suffisamment : fromage, viande, peau, blé, huile. Ce, sur tout le pourtour de l’île, mais aussi en terre ferme, notamment en Italie ou les vins du Cap son appréciés au moins depuis le Moyen-Âge.
Comme le reste de l’île, le Cap Corse va connaître des difficultés économiques liées à la politique coloniale de la France en Corse. Ainsi en 1818, une loi taxe les exportations corses. Il s’agit de permettre que les produits français soient leader (comme on dirait aujourd’hui) sur le marché. En faisant fi de l’économie insulaire.
Les conséquences sont désastreuses. C’est un coup d’arrêt aux échanges entre l’Italie et la Corse.
Dans le Cap, les marins sont alors obligés de se reconvertir. Ils se tournent vers l’agriculture. Pour cette raison, vous observerez nombre de muets de soutien de la terre végétale.
Les Cap Corsins, investissent la culture en terrasse.
Autre épisode tragique, celui du phylloxera qui, en 1878, contamine le vignoble du Cap Corse, soit à cette époque 1/3 du vignoble insulaire.
Les Cap Corsins accentuent alors la culture du cédrat, les vignes malades sont remplacées par les cédratiers.
Mais le Cap, qui a toujours une tradition maritime, voit dans le 20ème siècle l’occasion de grandes migrations. Les marins du Cap Corse émigrent vers l’Amérique du Sud où ils espèrent (ce sera le cas pour nombre d’entre eux) devenir riches.
En 1914, la Corse est impliquée dans le conflit de la première guerre mondiale. Le Cap Corse paie un lourd tribut. Avec les goumiers Africains, les Corses sont envoyés en premières ligne.
Quelques chiffres relatifs à la population du Cap Corse vous permettront, peut être de percevoir la gravité du problème.
- Vers 1870 : environ 18000 habitants
- Vers 1982 : environ 7000 habitants
- Vers 1990 : environ 13000 habitants
En 1942, la Corse est envahie par les troupes italiennes et allemandes, la résistance s’organise : la Corse sera le premier département français libéré.
Après la seconde guerre mondiale, le littoral du Cap Corse se développe de plus en plus les villageois désertent les montagnes pour s’installer sur la côte desservie par la départementale 80.
Dans les années 1960-1970, le phénomène s’accentue avec le tourisme vers lequel certaines familles se tournent entièrement.